Entretien avec Kai Sina | Thomas Mann : Radical et clair
Vous avez écrit un livre sur l'activisme politique de Thomas Mann et son combat contre les nazis : « Ce qui est bien et ce qui est mal ». On a parfois l'impression que vous sympathisez avec votre protagoniste. Est-ce aussi le reflet d'une certaine admiration pour Thomas Mann ?
Oui, on pourrait dire cela, mais c'est de l'admiration critique, pas de l'admiration religieuse. Je le considère comme l'un des intellectuels politiques les plus sages et les plus intéressants du XXe siècle, précisément parce qu'il n'a pas débuté comme tel. Il a d'abord dû développer ce rôle, l'apprendre et surmonter ses erreurs. Il n'était pas un démocrate-né, mais un chercheur. C'est ce qui le rend si intéressant pour nous aujourd'hui. La démocratie n'est pas une position figée, mais un cheminement parsemé d'erreurs, de contradictions et d'autocorrections. Cette évolution s'observe chez Thomas Mann d'une manière particulièrement impressionnante, et pour moi, carrément émouvante.
Il existe déjà de nombreux ouvrages secondaires sur l'œuvre et la vie de Thomas Mann. Vous écrivez que votre livre ne vise pas à offrir une explication définitive, mais plutôt une nouvelle description de Thomas Mann. Pourquoi une telle description est-elle nécessaire ?
Le Thomas Mann politique, et plus particulièrement le démocrate et le républicain qu'il se proclamait au début des années 1920, a rarement été pris au sérieux. Sa compréhension de la démocratie est jugée incomplète, voire problématique, et de toute façon, en tant que simple « républicain rationnel », il n'a jamais été véritablement convaincu par la démocratie. Même si l'on trouve des citations confirmant cette impression, on oublie que Thomas Mann considérait la politique moins comme une tâche de réflexion que comme un mandat concret d'action. « Il est fondamentalement pragmatique », écrivait-il un jour dans une lettre. C'est ici que je commence. Je recherche l'auteur politique là où il apparaît comme un acteur actif ; je m'intéresse à ce que, suivant John Dewey, on pourrait appeler la « démocratie quotidienne », la participation détaillée, tangible et prolongée au processus démocratique de formation de l'opinion. C'est précisément là que réside la force de Thomas Mann.
Ils soulignent la différence entre les formes d’articulation artistique-esthétique et politico-activiste de Thomas Mann.
Les romans et nouvelles de Thomas Mann présentent l'être humain dans toute sa complexité, comme un être contradictoire, vulnérable et en proie à l'insécurité. Même lorsque le fascisme devient un thème, notamment dans la nouvelle de 1930 « Mario et le Magicien », Mann s'attache à rendre psychologiquement plausible l'entrelacement entre la séduction charismatique et le plaisir de se soumettre à la raison. Il s'intéresse ainsi davantage à l'analyse littéraire qu'à l'accusation politique, comme ce fut le cas dans le grand roman allemand d'après-guerre « Le Docteur Faust ». L'orateur politique, quant à lui, doit établir et articuler des distinctions plus claires que celles qu'il juge souhaitables en tant qu'artiste. « Oui, nous savons à nouveau distinguer le bien du mal », déclarait Thomas Mann, par exemple, dans son discours de 1939 « Le Problème de la liberté », expliquant que nous vivons à une « ère de simplification ». Il s'agit incontestablement d'une phrase de militant politique, une phrase que le narrateur et romancier n'aurait jamais prononcée avec une telle exagération délibérée.
On sait qu'au début de la Première Guerre mondiale, Thomas Mann défendait l'Empire allemand dans des textes extrêmement nationalistes et saluait avec enthousiasme sa guerre contre les États démocratiquement constitués d'Angleterre et de France. Votre livre révèle avec surprise qu'avant cela, ses arguments politiques étaient plus libéraux et progressistes. Comment expliquer alors sa position nationaliste ?
Puis-je développer votre commentaire sur les années précédant 1914 ? Il est vraiment étonnant de constater à quel point Thomas Mann se positionnait clairement politiquement, voire résolument libéral, voire libéral de gauche, dès cette première phase. Heinrich Detering l'a retracé en détail dans l'édition de Francfort : en 1907, Thomas Mann prônait avec force l'abolition de la censure théâtrale d'État, qu'il qualifiait de « présomption d'État ». Dans un rapport de 1911 traitant des questions de pornographie et d'érotisme, il prônait une liberté sans restriction, même pour les formes d'art provocatrices, et s'opposait explicitement à l'ingérence des « philistins ou des fanatiques ». Parallèlement, il participa à diverses manifestations publiques : en 1910, il signa une pétition en soutien à l'anarchiste Erich Mühsam ; en 1911, il s'éleva contre l'interdiction des représentations des pièces de Wedekind ; Au printemps 1914, il participa à une déclaration contre la confiscation de la revue « Aktion », décrite dans la lettre de protestation qui l'accompagnait comme un « petit organe courageux et intelligent de la gauche littéraire ». Une impulsion politique se manifesta alors déjà, qui, sans encore aboutir à un programme précis, ne doit pas être sous-estimée : une forme d'activisme latent qui prit forme à la fin des années 1920 et connut son apogée en exil. Il est remarquable que ce lien ait longtemps été peu pris en compte. L'image d'un auteur resté dans une sorte de sommeil politique jusqu'au déclenchement de la guerre en 1914 persista.
Cela soulève la question de savoir comment ces écrits nationalistes et ivres de guerre ont pu être écrits à partir de 1914.
Oui, et je voudrais tout d'abord soutenir que cette rupture doit être véritablement comprise comme telle, et non pas balayée, comme cela s'est trop souvent produit. Même au sein de son cercle familial le plus proche, ce changement d'orientation fut accueilli avec incompréhension : « Les opinions politiques de Tommy sont plutôt embarrassantes », notait sa belle-mère, Hedwig Pringsheim, dans son journal à l'époque. Elle termina la lecture des « Réflexions d'un homme apolitique » en octobre 1918 « au prix de vives protestations ». Comment, dès lors, expliquer ce changement d'orientation ? Une théorie me paraît aujourd'hui tout à fait plausible : je vois dans l'auteur des écrits de guerre quelqu'un qui, au fond, se considérait comme un outsider – en tant qu'artiste et homosexuel – quelqu'un qui ne pouvait ou ne voulait pas se conformer aux normes du monde bourgeois. En 1914, il eut l'occasion de ne plus rester en retrait comme observateur, mais de rejoindre un mouvement collectif exaltant, et même de le diriger journalistiquement. À certains endroits des « Réflexions », on sent cependant qu'il n'était pas lui-même tout à fait à l'aise avec cette idée. Et qui sait, peut-être est-ce précisément cet épisode de séduction réactionnaire et de régression intérieure qui, plus tard, dans les années 1920, lui fit prendre conscience avec tant de clarté de la portée du fanatisme politique.
Reprenons le titre du gigantesque essai de Mann : Qu’est-ce qu’une « personne apolitique » ?
Thomas Mann définit l'« apolitique » comme un artiste qui se distancie consciemment de la politique quotidienne et prône plutôt l'intériorité, l'autonomie intellectuelle et les valeurs culturelles. La politique lui apparaît comme une sphère superficielle et corruptrice, incompatible avec l'art véritable. Pourtant, cette attitude est, bien sûr, tout sauf neutre : Mann oppose la « figure littéraire civilisée » occidentale-libérale à l'« artiste » allemand, symbole du sérieux créatif et de la « germanité ». Ainsi, s'éloigner du monde de l'esprit revêt une portée politique ; le repli sur le spirituel devient lui-même un geste idéologique, teinté de nationalisme.
Certaines positions de Thomas Mann à l'époque ne découlaient-elles pas également de sentiments familiaux, notamment de conflits avec son frère Heinrich Mann ? Il était également écrivain, partisan de la culture française, des idées des Lumières et de la raison. Comment évalueriez-vous l'influence de ces conflits avec son frère Heinrich sur Thomas Mann ?
Cette relation a été étudiée et décrite en détail, notamment par Hans Wißkirchen. Je ne peux rien y ajouter, d'autant plus que je perçois aussi le danger d'attribuer l'activité politique de Thomas et Heinrich Mann à des émotions familiales et de la minimiser ainsi. Peut-être seulement ceci : à mon avis, il ne s'agit pas seulement d'un conflit entre deux frères, mais aussi d'une force productive. Thomas Mann a dû se confronter à ce frère pour se trouver. C'est précisément parce qu'il a d'abord adopté une position aussi véhémente contre son frère qu'il a pu ensuite développer sa propre position de manière d'autant plus convaincante. La confrontation avec son frère a certainement été l'une des étapes décisives d'un apprentissage politique permanent. Néanmoins, je ne peux ni ne veux plaider ici pour l'un ou contre l'autre ; à mon avis, cela ne nous mènerait nulle part, d'autant plus que tous deux, en tant qu'auteurs et intellectuels politiques de leur époque, ont représenté bien plus que leur relation complexe de frères.
Dans quelle mesure la ville d’origine de Thomas Mann, Lübeck, dont le climat intellectuel est décrit en détail dans le roman « Les Buddenbrook », a-t-elle réellement façonné ses idées ?
Je crois que « Lübeck », plutôt que « l'Allemagne », a joué un rôle décisif dans la socialisation politique précoce de Thomas Mann. Il l'a lui-même souligné dans son discours de 1926 sur « Lübeck, mode de vie intellectuel ». Pour lui, la ville hanséatique symbolisait une communauté bourgeoise-républicaine fondée sur l'autonomie, le sens du devoir et la responsabilité culturelle. Cette éthique bourgeoise a profondément façonné sa pensée politique. Ce concept de « responsabilité » était déjà au cœur de son discours sur la République de 1922. À cet égard, je pense que Thomas Mann est moins apte à étayer la thèse, souvent débattue, d'un « Sonderweg allemand » en matière intellectuelle et politique .
À partir de 1929, durant la crise de la République de Weimar, les nationaux-socialistes d'Hitler remportèrent d'importants succès électoraux. Thomas Mann défendit inlassablement la démocratie lors de conférences publiques. Le publiciste de gauche Siegfried Kracauer lui témoigna un grand respect pour cela, mais il fit remarquer : « La bourgeoisie libérale dont rêvait Mann n'existait malheureusement pas dans l'Allemagne de Weimar. » Êtes-vous d'accord ? Thomas Mann lui-même le percevait-il ainsi ?
Je suis d'accord avec Kracauer. Dans ses discours, Thomas Mann s'adressait à une bourgeoisie libérale qui n'existait pratiquement pas dans la réalité de la fin de la République de Weimar. Son appel à la raison politique s'est heurté à une société de plus en plus marquée par les extrêmes. Jens Bisky l'a récemment démontré de manière impressionnante dans son livre « La Décision ». Mann lui-même reconnaissait cette contradiction, mais cela ne l'a pas empêché d'agir. Ses discours exprimaient sa foi dans le pouvoir de la raison, même s'il savait que la réalité sociale ne correspondait plus à cet idéal.
Après son exil en 1933, principalement aux États-Unis, Mann s'est affirmé comme militant, comme vous l'écrivez dans votre livre. Qu'entendez-vous par là ?
Je veux dire par là qu'en exil, notamment aux États-Unis, Thomas Mann a assumé et rempli son rôle de militant politique comme jamais auparavant. Sa maison de Pacific Palisades est devenue le centre de son activisme. Il rédigeait des discours, des messages radio et des appels ; il était en contact permanent avec des comités, des associations et des groupes politiques ; et de là, il a effectué plusieurs longues tournées de conférences à travers le pays, dans des villes côtières comme dans ce qu'on appelait le « Heartland ». Son souci n'était pas simplement de défendre la démocratie ; il la vivait comme une forme de responsabilité sociale. Dans cette action, dans ce rôle public, je dirais qu'il a pleinement développé son identité militante – et ainsi s'est réinventé en tant qu'intellectuel.
Thomas Mann a dit « oui » aux États-Unis et a accepté leur culture. À l'opposé d'Adorno, exilé de gauche, qui diabolisait cette même culture, la qualifiant de superficielle et de servile au capitalisme. Dans un passage de votre livre, vous semblez, en pensant à Thomas Mann, rejeter catégoriquement l'attitude culturellement critique d'Adorno envers les États-Unis. Que répondez-vous à Adorno ?
Mon objectif est moins de condamner la position d'Adorno que de rendre plus visibles les positions opposées ; ma sympathie personnelle peut résonner dans le livre, mais elle n'est pas décisive. Alors que Thomas Mann voyait la démocratie comme une opportunité pour une humanité active, Adorno incarnait l'attitude sceptique de l'observateur détaché, qui percevait dans l'industrie culturelle avant tout la perte d'autonomie et de pensée critique. Ainsi, deux attitudes s'affrontent : la participation engagée et la critique intellectuelle, toutes deux façonnées par l'exil, mais avec des réponses fondamentalement différentes aux défis de la modernité. Dans tout cela, la profonde gratitude de Thomas Mann envers les États-Unis ne doit certainement pas être sous-estimée.
À partir de 1940, Thomas Mann s'adressa directement à la population allemande lors de discours radiophoniques réguliers diffusés par la BBC. Ces textes, qui témoignent d'un engagement antinazi résolu, ont été largement négligés dans la réception de l'œuvre de Mann. Pourquoi, au juste ?
Les discours radiophoniques de Thomas Mann à la BBC, à partir de 1940, étaient des prises de position claires et courageuses contre le national-socialisme. Il évoquait le meurtre des Juifs, leur implication et leur culpabilité, et posait directement aux Allemands des questions embarrassantes. C'est précisément ce caractère radical et explicite qui lui a souvent valu des critiques dans l'après-guerre ; certaines déclarations, comme celles concernant le bombardement des villes allemandes, ne lui ont jamais été véritablement pardonnées. Accusé de moralisme depuis la sécurité de son exil, il a été considéré comme un traître, et a été la cible d'insultes virulentes. Cela explique pourquoi ces discours ont longtemps été ignorés ou dévalorisés. De plus, ils ne correspondaient pas à l'image d'un écrivain détaché, empreint d'une ironie détachée (qui est également un cliché). Le raffinement rhétorique avec lequel ces discours étaient construits, ainsi que leurs références à la Bible et au monde mythique (wagnérien), n'ont pu être reconnus que plus tard dans ces circonstances.
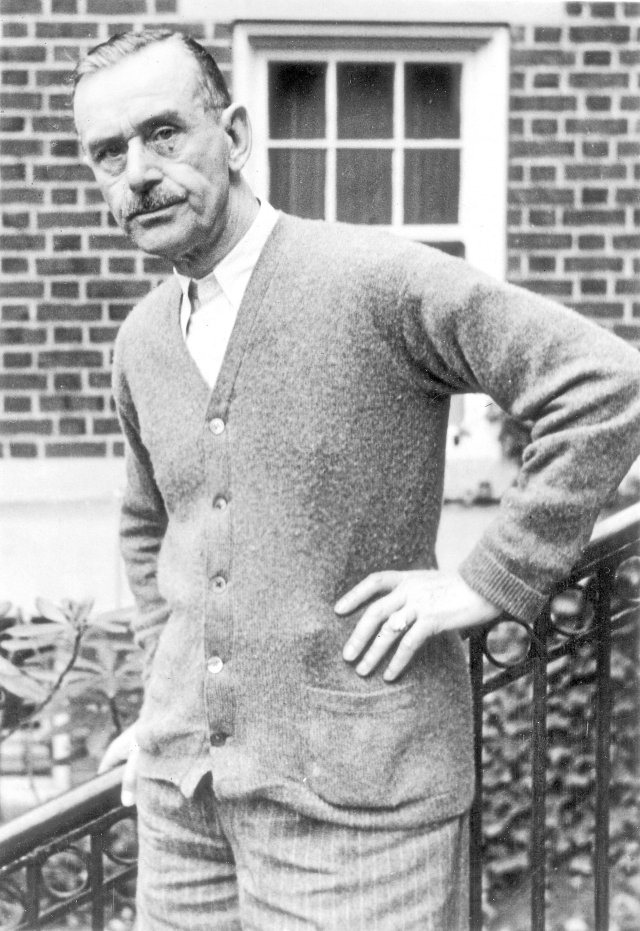
Une découverte surprenante dans votre livre est la rapidité et l’intensité avec lesquelles Thomas Mann a soutenu le sionisme, y compris lors de la fondation de l’État d’Israël en 1948. Quelles sont les raisons de cette position ?
Le plaidoyer de Thomas Mann en faveur du sionisme débuta dans les années 1920 et se poursuivit jusqu'à la fondation d'Israël en 1948, qu'il soutint sans réserve. Cet engagement est, en réalité, peu visible publiquement. L'une des raisons de cet engagement réside dans sa perception précoce et très claire de l'antisémitisme croissant dans la République de Weimar. Pour lui, le sionisme constituait aussi une réponse politique à cette haine, d'abord conçue culturellement, puis de plus en plus concrètement. Au plus tard en 1942, lorsqu'il prit conscience de l'ampleur de la Shoah, il devint un ardent défenseur de la création d'un État juif nouvellement créé, par conviction morale et responsabilité historique.
Néanmoins, le rapport de Thomas Mann au judaïsme peut aussi être source de malaise. Dans ses romans et essais, il souligne les grandes réussites civilisatrices de la culture juive classique, tout en semblant imprégné de stéréotypes, affirmant par exemple que les Juifs sont différents des autres. Qu'est-ce qui détermine exactement le rapport de Thomas Mann au judaïsme ? Y a-t-il réellement des éléments qui pourraient être qualifiés de racisme ?
Ces stéréotypes sont présents dans les récits et les romans, et parfois même dans les lettres et les journaux intimes. Je ne remets rien en question, ni ne relativise cela. Parfois, le discours de Thomas Mann, même lorsqu'il se qualifie explicitement de « philosémite », vire aux clichés antisémites. Mon objectif est plutôt de complexifier le tableau en considérant l'aversion de Mann pour l'antisémitisme politique et son opposition engagée à celui-ci, ainsi que, bien sûr, son plaidoyer en faveur du sionisme. J'ai l'impression que, concernant la relation de Thomas Mann avec « les » Juifs, tout jugement, tout jugement général, est proscrit.
nd-aktuell





