Trump obtient une trêve historique, pas la paix
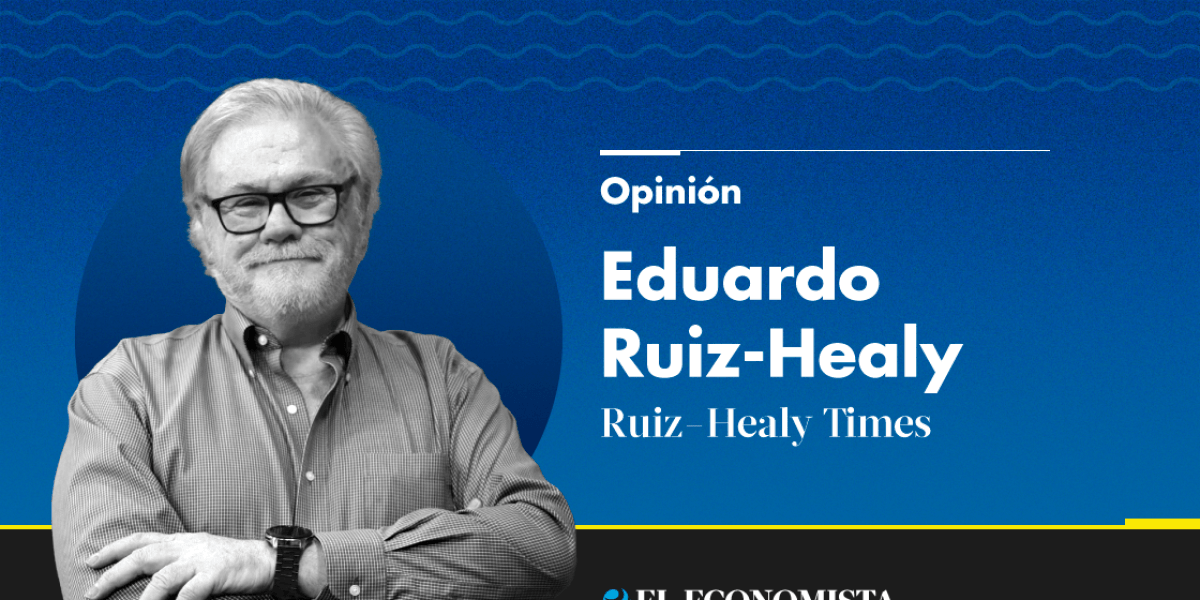
Donald Trump a obtenu ce que beaucoup considéraient comme impossible : une trêve à Gaza. Après des mois de guerre, de destruction et plus de 67 000 morts palestiniens, le cessez-le-feu du 10 octobre offre un répit à une population épuisée. Le plus surprenant est que Trump y soit parvenu malgré la résistance du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas d'État palestinien, et de la méfiance des dirigeants du Hamas. Sous une forte pression internationale et au prix de promesses graduelles, les deux parties ont accepté l'accord.
Le Sommet de la paix 2025 s'est tenu hier à Charm el-Cheikh, en Égypte, où le pacte a été signé. Des représentants de 34 pays y ont participé, dont les chefs d'État ou de gouvernement d'Allemagne, d'Azerbaïdjan, de Bahreïn, du Canada, de Chypre, d'Égypte, des Émirats arabes unis, d'Espagne, des États-Unis, de France, de Grèce, de Hongrie, d'Irak, d'Italie, d'Indonésie, de Jordanie, du Koweït, de Norvège, du Pakistan, de Palestine, du Qatar, du Royaume-Uni, de Turquie et de Turquie. Au moins douze d'entre eux dirigent des régimes autoritaires ou totalitaires, et deux d'entre eux – Abdel Fattah al-Sissi en Égypte et Recep Tayyip Erdoğan en Turquie – ont été décrits par Trump comme des dirigeants forts et déterminés, des qualificatifs qui peuvent être interprétés comme une approbation de leur autoritarisme.
Les dirigeants d'organisations multilatérales telles que l'ONU, la Ligue arabe et le Conseil de l'Europe étaient également présents. La Chine et la Russie n'ont envoyé ni délégations officielles ni observateurs. La composition de la liste a donné au sommet une impression de consensus mondial, même si, en pratique, elle a davantage constitué un soutien politique à la trêve soutenue par Trump qu'un véritable progrès vers la paix.
La séance plénière, réunissant les 34 délégués, s'est tenue à huis clos. Le futur gouvernement civil de Gaza, la reconstruction humanitaire et les garanties de sécurité ont été abordés. Le résultat a été largement symbolique : Israël n'a pas signé l'accord et n'a envoyé qu'une représentation technique. Le Hamas a accepté de céder une partie de l'administration civile de Gaza, mais a jusqu'à présent refusé de désarmer.
Trump a proclamé que « la fin du terrorisme a commencé » et que « ce qui n'avait pu être accompli en 3 000 ans » a été réalisé. Cette affirmation grandiloquente était inexacte, car ni Israël ni le Hamas n'ont signé le document, et l'accord est dépourvu de véritables mécanismes pour en garantir l'application. Il avait néanmoins une valeur symbolique : il a permis à la communauté internationale de s'aligner, ne serait-ce que pour un instant, sur l'idée d'une paix possible.
Cet enthousiasme n'est pas nouveau. Carter, Clinton et Bush Jr. ont également fait adopter des accords au Moyen-Orient – Camp David, Oslo et la « Feuille de route » – salués comme des étapes importantes, mais qui ont échoué faute de s'attaquer aux causes structurelles du conflit : l'occupation de la Palestine, les colonies israéliennes illégales, le blocus de Gaza et l'absence de reconnaissance mutuelle. Trump répète ce schéma : il promet la fin des violences sur des bases aussi fragiles que celles de ses prédécesseurs.
La réunion en Égypte a révélé un ordre fragmenté : un sommet dominé par des gouvernements autoritaires et une paix encore lointaine et précaire. Pourtant, la libération des Israéliens kidnappés et des milliers de Palestiniens détenus sans procès est restée le premier véritable geste de réconciliation : modeste, fragile, mais plus authentique que n’importe quel discours.
Facebook : Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram : ruizhealy
Site Web : ruizhealytimes.com
Eleconomista





