Le secteur de la recherche et le phénomène des « usines à papier »

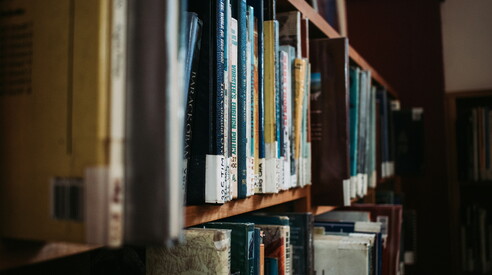
Photo de Muaawiyah Dadabhay sur Unsplash
Une crise silencieuse
La science se plie à la dictature des publications, et certains en profitent. Enquête sur un modèle défaillant.
Sur le même sujet :
Il y a une crise silencieuse dans le monde scientifique. Ce n'est ni un virus, ni un conflit entre théories académiques : l'ennemi aujourd'hui, ce sont les publications elles-mêmes. On l'appelle la « mouline à papier » – ou « cartiere » en italien – et elle identifie un phénomène inquiétant et en constante expansion : la production et la publication massives d'articles scientifiques faux, non fondés, non vérifiés et savamment construits, dans le seul but de booster des carrières, d'obtenir des financements ou simplement de « gonfler » les CV académiques . Une enquête du New York Times s'est récemment penchée sur ce monde opaque et caché, mais le problème est ancien, répandu et malheureusement voué à s'aggraver.
Les premiers rapports systématiques sur le phénomène des usines à papier concernaient la Chine, considérée par de nombreux analystes comme le véritable épicentre de la prolifération de ces mécanismes frauduleux. Il a notamment été démontré que certains hôpitaux universitaires et instituts de recherche chinois ont recours depuis des années à des services de rédaction scientifique payants pour garantir la publication de leurs médecins et chercheurs dans des revues indexées, souvent une condition essentielle à leur avancement professionnel ou à leur promotion. Ce modèle a depuis évolué vers un véritable marché parallèle, capable de produire des articles sur mesure, agrémentés de données fictives, d'images manipulées et de citations savamment construites .

Le phénomène est d'autant plus complexe que le système universitaire chinois est fortement touché par les autocitations : selon certaines analyses, plus de 60 % des citations d'ouvrages publiés en Chine proviennent de chercheurs chinois eux-mêmes. Ce chiffre contribue à déformer la véritable influence scientifique de la Chine et suggère l'existence de pratiques structurées, telles que le « citation stacking », ou citations mutuelles, destinées à accroître l'impact académique . Dans ce contexte, la Chine a ouvert la voie en exportant un modèle aujourd'hui reproduit, avec des variantes, dans d'autres pays.
Après la Chine et les États-Unis, l'Italie se classe troisième au niveau mondial en matière de citation stacking. Une étude scientifique publiée dans Plos One a analysé cette pratique chez les chercheurs italiens. Il est important de noter que les chiffres italiens sont nettement inférieurs à ceux de la Chine. Cependant, compte tenu de l'état actuel de la recherche en Italie – un pays avec peu de diplômés, peu de chercheurs et peu de financement pour le secteur – le nombre élevé de publications qui a propulsé l'Italie au sommet du classement mondial est frappant. Ces chiffres peuvent toutefois susciter des inquiétudes. Antonio Cassone , microbiologiste et ancien directeur du département des maladies infectieuses de l'Istituto Superiore di Sanità, a confirmé ces doutes à Il Foglio : « Les chercheurs italiens sont certes très productifs, mais la montée en puissance de notre pays dans les classements mondiaux ces dernières années peut jeter le doute sur la validité scientifique de certains de leurs travaux. » Cassone, auteur d'un essai récent sur le sujet, ajoute : « Il ne s'agit plus d'erreurs occasionnelles ou de recherches de mauvaise qualité. Nous avons affaire à un système parallèle, un marché organisé, qui exploite le besoin de publier pour faire avancer sa carrière. »
Selon Cassone, le moteur de ce phénomène est la pression insoutenable exercée sur les chercheurs. Dans le monde universitaire, publier est une nécessité, quel que soit le contenu ; seul compte réellement que le nom de l'auteur apparaisse noir sur blanc dans une revue, de préférence internationale. Cassone cite un chiffre révélateur qui illustre l'ampleur du phénomène : l'année dernière, environ 2,5 millions d'articles scientifiques ont été publiés dans le monde . Ce chiffre soulève une question cruciale : quelle part de cette production représente une science véritable, vérifiable, rigoureuse et utile au progrès ? C'est une question que nous ne pouvons plus ignorer, car la proportion d'ouvrages de mauvaise qualité ou entièrement fictifs croît de manière exponentielle.
Giuseppe Novelli, généticien et ancien recteur de l'Université Tor Vergata de Rome, dénonce également ce phénomène : « Il ne s'agit pas simplement d'articles mal rédigés. Le problème est que nombre de ces études sont générées, ou largement manipulées, grâce à l'intelligence artificielle. » Novelli explique à Il Foglio que l'IA, bien qu'elle offre de puissants outils pour la recherche, peut présenter un risque si elle est utilisée sans un examen critique adéquat. L'IA peut contribuer à la diffusion de fausses informations, construire des phrases vides de sens et générer des citations incorrectes ou inappropriées. Un exemple courant : lire des phrases citant des articles comme « récemment publiés » pour découvrir ensuite que les études en question datent de six, voire sept ans. Pour Novelli, « c'est une erreur typique de l'intelligence artificielle : elle manque d'esprit critique, ne comprend pas le contexte temporel et, dans de nombreux cas, n'a accès qu'aux résumés de certaines études, souvent accessibles uniquement par abonnement payant. »
Mais le problème ne se limite pas à l'utilisation abusive de l'IA. Novelli souligne également l'effondrement de la qualité de l'évaluation par les pairs, processus censé garantir la fiabilité des articles scientifiques. Trop de revues, trop d'articles à évaluer, et trop peu d'évaluateurs compétents prêts à y consacrer le temps nécessaire. Résultat : des études incohérentes, voire frauduleuses, parviennent à passer le contrôle éditorial et à être publiées dans des revues utilisant ce modèle économique. Il n'est pas rare qu'un article publié coûte entre 3 000 et 4 000 euros, tandis que certains « services d'édition », promettant une publication clé en main, proposent des packages complets pouvant atteindre 30 000 euros . Un marché de plusieurs millions de dollars qui, plutôt que de promouvoir la rigueur scientifique, vise le profit.
Cette augmentation des publications suspectes est due à un système d'incitation profondément défaillant. Giuseppe Traversa, épidémiologiste et ancien chercheur à l'Istituto Superiore di Sanità, soutient également cette affirmation. Traversa explique à Il Foglio qu'aujourd'hui, en recherche, le mérite est jugé principalement sur le nombre d'articles publiés et de citations reçues. Ce système récompense clairement la quantité, et non la qualité. Si 100 publications, même modestes, suffisent à remporter un concours ou à obtenir un financement, la tentation de « gonfler » sa réputation devient irrésistible . Les conséquences sont désastreuses et multiples. Premièrement, les fonds publics, déjà rares, risquent d'être détournés vers des projets de faible valeur, privant ainsi ceux qui mènent une recherche véritablement de qualité. Mais le dommage le plus profond réside dans la perte de confiance. Lorsque même ceux qui observent la science de l'extérieur commencent à soupçonner que derrière certaines publications se cache un vide – ou pire, une fraude délibérée –, c'est tout le système qui vacille. Nous l'avons clairement constaté pendant la pandémie, lorsque les fausses nouvelles et les études non vérifiées ont contribué à semer la confusion et la méfiance.
Selon Cassone, pour rétablir la crédibilité, une révolution culturelle est nécessaire : il faut revenir à une récompense de la qualité de la recherche, et non du nombre de publications. On ne peut plus juger un chercheur uniquement à l’aune de la revue dans laquelle il publie ; il faut lire ce qu’il écrit, en comprendre le contenu et évaluer sa contribution réelle. Novelli insiste également sur des contrôles plus rigoureux : une vérification éditoriale préalable efficace est nécessaire, ainsi qu’une relecture multidisciplinaire renforcée. Enfin, Traversa souligne l’urgence de réformer le système d’incitation : il faut évaluer la valeur réelle de la recherche, et non le nombre abstrait de publications. Les trois experts s'accordent à dire que, pour l'instant, le système italien est moins exposé que dans d'autres pays, où les carrières universitaires sont étroitement liées à la performance éditoriale. Mais cela ne signifie pas que nous sommes à l'abri. Erreurs grossières, superficialité, déformations et manipulations subtiles sont déjà présentes dans le paysage scientifique italien . Et la facilité avec laquelle il est désormais possible d'acheter une étude prête à être publiée devrait alerter les institutions et les communautés universitaires.
La science est par nature un processus autocorrecteur, et avec le temps, la fraude a tendance à apparaître. C'est pourquoi la surveillance doit être préventive, et pas seulement a posteriori : une vigilance accrue, une plus grande rigueur et une plus grande transparence sont nécessaires à chaque étape du processus de publication. En fin de compte, conclut Cassone, « cette histoire a commencé avec un petit grain de sable ». Mais si nous n'y prêtons pas attention, ce grain risque de se transformer en une avalanche capable de tout anéantir, même la foi que nous avons placée depuis des siècles dans le pouvoir de la raison.
En savoir plus sur ces sujets :
ilmanifesto





