On m'a diagnostiqué un cancer incurable. Ce traitement futuriste pourrait me sauver.

À l'automne 2003, j'ai glissé sur la glace en quittant mon bureau un soir. Ma hanche m'a fait mal pendant un an, mais je l'ai ignorée la plupart du temps. La douleur persistant, j'ai consulté mon médecin, qui m'a prescrit une IRM. Je me suis rendu à son cabinet et il m'a annoncé une tumeur à la hanche. J'avais 38 ans, je poursuivais une carrière prometteuse dans le journalisme, j'étais marié à une femme que j'aimais et j'étais papa pour la première fois d'une fille de sept mois.
Au moment où l'on m'a diagnostiqué le type de cancer dont je souffrais, une forme rare et incurable de cancer du sang appelée myélome multiple, on m'a annoncé qu'il ne me restait que dix-huit mois à vivre. C'était il y a plus de vingt et un ans.
Au cours de ces vingt et une années, j'ai subi une avalanche de traitements pour combattre ma maladie. Parmi ceux-ci, on compte quatre séances de radiothérapie (à la hanche, au cou, aux côtes et au nez) ; un traitement de six mois d'immunothérapie intraveineuse hebdomadaire (suivi de sept ans d'un traitement d'entretien sous forme de comprimés) ; un autre traitement de deux ans d'immunothérapie utilisant les versions nouvelle génération des médicaments que je prenais auparavant, sous forme de comprimés ; un troisième traitement d'immunothérapie utilisant deux nouveaux médicaments administrés chaque semaine par voie intraveineuse pendant deux ans supplémentaires ; et six ans (et ce n'est pas fini) de perfusions intraveineuses mensuelles d'un agent utilisé pour renforcer mon système immunitaire, affaibli à la fois par ma maladie et par les traitements utilisés pour la combattre. Mais le traitement le plus remarquable que j'ai reçu jusqu'à présent est une procédure de pointe, approuvée par la FDA pour des cas comme le mien seulement en 2022, appelée thérapie CAR-T. Voici l'histoire de ce traitement.
Cette fois, je n'ai pas glissé sur la glace. Je me suis penché pour remplir le lave-vaisselle et j'ai ressenti une vive douleur dans le dos. C'était en février 2023. Mon oncologue, le Dr Sundar Jagannath, de l'hôpital Mount Sinai de New York, a prescrit une série d'analyses sanguines et de scanners. Ils ont montré que j'étais sorti de rémission, pour la septième fois. J'avais des tumeurs à la hanche, aux côtes, ainsi qu'aux vertèbres thoracique et lombaire.
Par une journée de mars d'une beauté incongrue, ma femme Didi et moi avons rencontré le Dr Jagannath. Il m'a expliqué que ma meilleure option thérapeutique était une immunothérapie quasi-inédite, à la pointe de la technologie et d'un futurisme presque hallucinant, appelée thérapie CAR-T. Ce serait le traitement le plus puissant et le plus dangereux que j'aie jamais reçu.
La thérapie CAR-T consiste à prélever des lymphocytes T dans votre sang, puis à les envoyer en laboratoire où une protéine appelée récepteur d'antigène chimérique (CAR) est ajoutée à leur surface (d'où l'acronyme « CAR-T »). Cette protéine CAR aide les lymphocytes T à reconnaître les antigènes présents à la surface de cellules cancéreuses spécifiques, dans mon cas des cellules myélomateuses, afin qu'ils puissent cibler et détruire les cellules malignes. Les lymphocytes T chargés de CAR sont ensuite réinjectés dans votre organisme par voie intraveineuse pour accomplir leur action.

Lorsque j’ai commencé CAR-T, ma femme, Didi, et moi avions des dizaines de questions.
Le CAR-T est une thérapie dite « unique » ; elle nécessite peu de soins d'entretien continus, a-t-il expliqué. Si cela fonctionnait, je pourrais reprendre une vie relativement normale, au moins pendant un certain temps, avec peu ou pas de traitement d'entretien.
Naturellement, il y avait des réserves. Le CAR-T n'est en aucun cas efficace à 100 %, il nécessite des mois de préparation, parfois complexes et désagréables, et il présente de nombreux effets secondaires potentiellement invalidants, voire mortels.
La définition scientifique de « chimère » – le mot clé de « récepteur antigénique chimérique » – est une partie du corps constituée de tissus au matériel génétique diversifié. Cependant, ce terme a deux autres significations. L'une est un monstre imaginaire composé de parties incongrues. L'autre est une illusion, plus précisément un rêve irréalisable. Les deux semblaient pertinentes.
La thérapie CAR-T étant complexe et hautement spécialisée, le Dr Jagannath m'a orientée vers un spécialiste CAR-T pour gérer mon traitement. Didi et moi avons eu notre premier rendez-vous avec le Dr Shambavi Richard quelques semaines plus tard.
Femme indo-américaine aux longs cheveux noirs qui privilégie les lunettes élégantes, le Dr Richard équilibre une attitude amicale et décontractée avec une profonde expertise professionnelle.
La préparation du CAR-T, m'a-t-elle expliqué, était effectivement complexe. Dans mon cas, elle inclurait des dizaines d'analyses sanguines ; une biopsie osseuse et une biopsie de moelle osseuse ; une procédure pour prélever mes lymphocytes T ; éventuellement une radiothérapie supplémentaire si les tumeurs osseuses devenaient problématiques avant que je reçoive mon CAR-T (il faut environ un mois après le prélèvement pour que les cellules turbocompressées soient fabriquées ; une hospitalisation de quatre jours pour administrer une chimiothérapie appelée DCEP, destinée à réduire le nombre de cellules myélomateuses dans l'organisme afin d'accroître l'efficacité du traitement CAR-T ; trois jours de traitement ambulatoire appelé lymphodéplétion, une autre forme de chimiothérapie, qui détruit vos lymphocytes T existants pour aider les lymphocytes T bio-ingérés à attaquer les cellules myélomateuses plus efficacement ; et la pose d'un cathéter thoracique qui servirait à perfuser les lymphocytes CAR-T, à administrer les médicaments associés et à prélever du sang pour surveiller ma numération globulaire pendant les deux semaines d'hospitalisation nécessaires à la perfusion de CAR-T.
Les deux effets secondaires les plus graves de la thérapie CAR-T, nous a-t-elle expliqué, sont le syndrome de libération de cytokines et la neurotoxicité. Le syndrome de libération de cytokines, ou SLC, survient lorsque le système immunitaire réagit de manière trop agressive à une infection. Dans le cas de la thérapie CAR-T, l'organisme semble confondre les cellules génétiquement modifiées avec une infection, déclenchant ainsi une réaction indésirable. Les symptômes du SLC comprennent fièvre et frissons (« tremblement et cuisson » comme disent certains médecins), fatigue, diarrhée, nausées et vomissements, maux de tête, toux et hypotension artérielle. Non traité rapidement, ce syndrome peut être mortel.
La neurotoxicité est un terme générique désignant un ensemble de symptômes neurologiques pouvant inclure des maux de tête, une confusion, un délire, des troubles de l'élocution ou de la parole, des convulsions et un œdème cérébral (gonflement du cerveau). Ce trouble peut également être mortel s'il n'est pas traité immédiatement.
Le traitement CAR-T laisse également les patients gravement immunodéprimés et vulnérables aux infections pendant des mois, voire des années. Leur système immunitaire est tellement affaibli qu'ils doivent finalement recevoir tous leurs vaccins infantiles (oreillons, rougeole, rubéole, etc.), sans parler des vaccins contre la COVID-19 et la grippe. Tant qu'ils n'auront pas reçu ces vaccins, ce qui ne peut se faire qu'au moins six mois après le traitement CAR-T, ils seront vulnérables à toutes ces maladies et à d'autres. Lors de mes séjours à l'hôpital, je n'aurais droit qu'à un nombre limité de visiteurs, et ils devraient tous porter un masque. De retour chez moi, je devrais vivre avec plus de prudence que je ne l'avais fait, comme nous l'avons tous fait au début de la COVID-19.

On m’a diagnostiqué un myélome à 38 ans, alors que j’étais un jeune père.
Didi et moi avions des dizaines de questions. Attends, comment fonctionne le CAR-T, déjà ? La récolte de lymphocytes T provoquerait-elle les mêmes picotements de fourmis rouges que ma récolte de cellules souches ? Pourrais-je assister au mariage de ma nièce à Cape Cod en août ?
En plus d'être un médecin de renommée mondiale, le Dr Richard est d'une écoute irréprochable. Elle a patiemment répondu à toutes nos questions, nous a assuré que son cabinet organiserait les rendez-vous nécessaires et nous a laissés partir.
Didi et moi avons pris un taxi pour rentrer. En descendant la Cinquième Avenue, nous étions étrangement optimistes. Mieux vaut agir que ne rien faire. Et j'allais devenir bionique.
J'ai fait les analyses de sang, les biopsies et le prélèvement de lymphocytes T. Finalement, je n'ai pas eu besoin de radiothérapie.
En prévision de la perte de mes cheveux pendant les deux séances de chimiothérapie, je me suis fait couper les cheveux en brosse. Il me semblait que perdre des mèches courtes serait moins traumatisant que de longues. Quand mon coiffeur m'a fait remarquer que c'était un choix radical pour moi, j'ai menti en disant que je voulais rester au frais pendant l'été. Puis, le jeudi 11 mai, je me suis enregistré au Mount Sinai pour commencer mon traitement DCEP de quatre jours.
« DCEP » est l'acronyme approximatif de « Dexaméthasone, Cyclophosphamide, Étoposide et Cisplatine », les quatre médicaments qui composent le traitement. Ils sont administrés par voie intraveineuse. À 16 heures cet après-midi-là, j'étais confortablement installé dans ma chambre au onzième étage de l'hôpital et branché à une potence.
Comme le DCEP doit être administré en continu, j'étais branché à ma perfusion 24 heures sur 24. J'ai été branché à de nombreuses perfusions, et je dois vous dire que les pompes électroniques utilisées pour les administrer sont défectueuses. Le plus embêtant, c'est que les alarmes dont sont équipés les appareils, censées se déclencher uniquement en cas de problème d'écoulement du médicament, se déclenchent souvent sans raison. À chaque fois, une infirmière doit venir vérifier que tout va bien et réinitialiser la pompe. Être branché à une pompe 24 heures sur 24 peut être exaspérant. Ce n'est certainement pas propice au sommeil.
Après quatre jours d'hospitalisation, j'avais hâte de rentrer chez moi. Physiquement, je me sentais bien. Heureusement, j'avais bien supporté le DCEP sans pratiquement aucun effet secondaire. Mais j'étais épuisé par le manque de sommeil et émotionnellement épuisé.
Juste après le dîner de mon quatrième jour, j'ai été libéré.
Le lendemain matin, après que mon fils Oscar soit parti à l'école, je me suis assis sur le canapé du salon. Didi était à la table de la salle à manger, travaillant sur son ordinateur portable.
« Tu sais ce qui est bien ? » dis-je.
Depuis mon départ pour l'hôpital jusqu'à ce moment-là, je n'avais ressenti ni peur ni inquiétude particulières. Durant les quatre-vingt-seize heures passées au Mont Sinaï, j'avais simplement fait ce que j'avais à faire.
J'ai commencé à répondre à ma propre question. J'avais l'intention de dire : « Dormir dans ton propre lit. » Mais avant même d'avoir pu terminer ma phrase, toutes les émotions que j'avais apparemment refoulées au cours des quatre derniers jours à l'hôpital, ou peut-être des dix-neuf années précédentes, ont refait surface.

Malgré le succès du traitement, j’ai toujours peur de laisser mon fils, Oscar, et ma fille, AJ, sans père.
Je suis une personne relativement stoïque. Je ne me laisse pas facilement submerger par mes problèmes. Je n'ai même pas envie d'en parler.
Eh bien, le cancer transforme les stoïques en menteurs. Tout comme il attaque votre corps, il attaque vos défenses émotionnelles, et ne s'arrête que lorsqu'il vous les a dépouillées. Vous voulez vous battre pendant dix-neuf ans ? Pas de problème. Le cancer est patient. Il attendra. Il se moque de votre persévérance. Il se moque de votre raideur. Il s'amuse de votre courage. Finalement, il vous brisera. Vous pouvez entrer dans le cancer en stoïque, mais vous n'en sortirez pas en tant que tel.
J'ai commencé à pleurer. Des hurlements, vraiment. Un gémissement profond, primitif et laid. C'était la première fois que je pleurais aussi fort depuis le diagnostic. Contrairement à mes instincts stoïques, pleurer ne m'a pas fait me sentir faible ou honteux. Cela m'a soulagé. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé dix-neuf ans de poids des épaules.
« Vous m'avez tellement manqué », ai-je réussi à dire à Didi entre deux respirations. « Je suis si heureuse d'être à la maison. »
On m'a demandé si j'avais peur de mourir. La réponse est non, pas vraiment. Après avoir longuement réfléchi à la question, j'ai fini par l'accepter. Pour moi, la mort, c'est la mort. Ni paradis ni enfer. Juste de la nourriture pour vers. Le néant. Pourquoi devrais-je avoir peur de rien ?
Ce qui me fait peur, c'est la souffrance. J'ai vu la souffrance de près, dans les cabinets d'oncologues, dans les centres de soins et dans les services de cancérologie. C'est vraiment effrayant.
Lors de mes séances de radiothérapie, j'ai vu des patients présentant des brûlures cutanées si graves qu'elles ressemblaient à des victimes d'incendie criminel. Lors de mes séances, j'ai vu un homme mouiller son pantalon sur sa chaise pendant son sommeil ; une femme s'effondrer en allant aux toilettes, se fendre la tête et saigner sur le sol ; et des toilettes couvertes d'éclaboussures de diarrhée. Lors de mes séjours à l'hôpital, j'ai vu des patients chauves, émaciés et aussi pâles que les couvertures blanches d'hôpital dans lesquelles ils étaient enveloppés pour se tenir chaud. J'ai entendu des gémissements, des cris et des bruits que je ne sais franchement pas comment décrire. Les services de cancérologie ont été qualifiés de « maisons de l'horreur ». J'aimerais pouvoir contester cette qualification.
J'ai toujours peur de laisser Oscar et ma fille, AJ, sans père. Non pas que je pense qu'ils s'en sortiront mal. J'ai une confiance inébranlable en eux. Mais s'il y a une chose innée chez les parents de l'espèce humaine, c'est de subvenir aux besoins de leur progéniture. Ne pas pouvoir le faire, même si cette incapacité est indépendante de ma volonté, serait, pour moi, un échec impardonnable.
J'aimerais aussi voir AJ et Oscar grandir, démarrer leur carrière, se marier et avoir des enfants s'ils le souhaitent. J'aimerais passer ma retraite avec Didi, écrire davantage, pêcher davantage, jouer davantage au poker et voyager davantage avec ma famille et mes amis.
Je n'ai pas peur d'être mort. J'ai peur de ne plus être en vie.
Le DCEP était censé être un lion. Physiquement, du moins, c'était un agneau. La lymphodéplétion était censée être un agneau. Il s'est avéré qu'il avait une morsure.
Mes séances étaient prévues pour le jeudi, le vendredi et le samedi. Le dimanche était libre comme jour de repos. Lundi, je devais me rendre à l'hôpital pour mon traitement CAR-T.
Comme le DCEP, la lymphodéplétion est administrée par voie intraveineuse, mais en ambulatoire. Après ma première perfusion, je me sentais bien. Après la deuxième, je me sentais mal. Après la troisième, je me sentais aussi mal que je l'avais été après tous mes traitements contre le cancer. J'avais des nausées, des vertiges et j'étais si faible que je pouvais à peine boire un verre d'eau ou sortir du lit. Je devais ramper à quatre pattes pour aller aux toilettes.
Pour le meilleur ou pour le pire, les humains ont tendance à considérer une chevelure abondante comme un signe de bonne santé et la perte de cheveux comme un signe révélateur de cancer. J'ai toujours eu une belle chevelure. Adulte, j'ai tendance à la porter longue sur le dessus et courte sur les côtés, avec une mèche qui pend sur mon front. Didi appelle ça ma boucle Superman.
Bien que mes cheveux aient commencé à tomber légèrement pendant le DCEP, ils sont maintenant complètement tombés. Sous ma douche, la mousse de shampoing dans mes mains était parsemée de milliers de petits poils noirs et gris.
C'était plus bouleversant que je ne l'aurais cru. Ma tentative d'anticiper ce sentiment en me faisant couper les cheveux en boule n'a pas vraiment fonctionné – il y a des choses auxquelles on ne peut pas se préparer. Après presque vingt ans, j'avais enfin ressenti l'effet secondaire le plus familier du cancer. Perdre mes cheveux était un signe indéniable et indéniable de ma maladie, et ça faisait mal. La boucle de Superman avait disparu.
Après mon dernier traitement de lymphodéplétion, j'ai pris un taxi pour rentrer de l'hôpital. C'était le samedi 24 juin 2023, la veille de la Marche des fiertés de New York, et comme plusieurs rues principales étaient déjà bloquées, la circulation était bloquée. Un trajet qui aurait normalement pris quarante-cinq minutes avait déjà duré plus d'une heure, et il me restait encore plus de vingt pâtés de maisons à parcourir.
Alors que nous avancions lentement sur Park Avenue South, un pick-up s'est arrêté à côté de ma cabine. C'était un Ford F-150 rouge immatriculé dans le New Jersey. Le conducteur et le passager avant étaient des jeunes hommes d'une vingtaine d'années, vêtus de débardeurs et de casquettes de baseball. Du Bon Jovi sortait à plein volume de leurs haut-parleurs. S'ils avaient été des personnages de film, on les aurait ignorés, les trouvant trop osés.

En prévision de la perte de mes cheveux au cours des deux cycles de chimiothérapie, je me suis fait couper les cheveux en brosse.
Comme on le fait lorsqu'on est en train de se faire détruire le système immunitaire en prévision d'un traitement contre le cancer futuriste, je portais un masque à l'arrière de la cabine et j'avais la vitre baissée. Le chauffeur du pick-up, qui se trouvait maintenant à quelques mètres à peine de moi sur la voie à ma droite, avait lui aussi la vitre ouverte. Avant même qu'il ne parle, je savais ce qu'il allait dire.
La citation exacte était : « Mec, enlève le masque. » Son ailier a ri.
Dans ma famille, on aime raconter l'histoire de mon père. Quand j'avais environ cinq ans, nous étions tous les six, mon père, ma mère, mes trois frères et sœurs et moi, à skier dans le nord de l'État de New York. C'était un jour particulièrement chargé et il y avait une longue file d'attente pour une des remontées mécaniques.
Lorsqu'un groupe d'adolescents a essayé de passer devant, mon père, qui était une âme réputée douce mais qui croyait aussi aux règles, les a interpellés.
« Désolé, les gars », dit-il. « On attend tous ici depuis longtemps. Vous devez aller au bout de la file. »
Les enfants l'ont ignoré.
« Les gars, allez à l’arrière. »
Rien.
"Les gars …"
Et puis : « Va te faire foutre, vieux. »
C'était ça. Quelque chose en moi, mon père, d'ordinaire si doux, s'est brisé. Il a retiré ses bottes de ski, s'est dirigé vers les enfants et a attrapé le chef de meute par le revers de son manteau.
« Va au fond », dit-il. « Maintenant ! »
Et ils sont allés vers l'arrière.
De retour sur Park Avenue South, j'ai canalisé mon Gene Gluck intérieur.
Je suis sorti du taxi (la circulation était de toute façon arrêtée) et je me suis approché du chauffeur de la camionnette.
Mon soliloque de quartier ressemblait à ça : « Je suis atteint d'un cancer, connard. Je rentre chez moi après une séance de chimiothérapie. Lundi, je pars à l'hôpital pour deux semaines de traitement qui pourrait me tuer. Je porte un masque parce que mon système immunitaire est défaillant. Va te faire foutre. »
En termes de puissance de ma performance, cela n'a pas fait de mal que, grâce au DCEP et à la lymphodéplétion, je n'avais pas seulement perdu la plupart de mes cheveux, mais j'étais également mince et d'apparence cendrée.
Pour être honnête, dès que je suis sorti du taxi, le chauffeur a semblé comprendre ce qui se passait, et une fois que j'ai confirmé ses soupçons, il a semblé sincèrement regretter.
« Désolé, mec », dit-il. « C'est ma faute. »
Je suis remonté dans le taxi et lui et son acolyte ont tourné à droite au carrefour suivant, je suppose pour éviter d'avoir à avancer lentement à côté de moi plus longtemps.
D'habitude, je ne crois pas qu'il faille jouer la carte du cancer. Dans la plupart des cas, c'est un outil trop puissant, et même manipulateur. Mais ce jour-là, j'ai fait une exception.
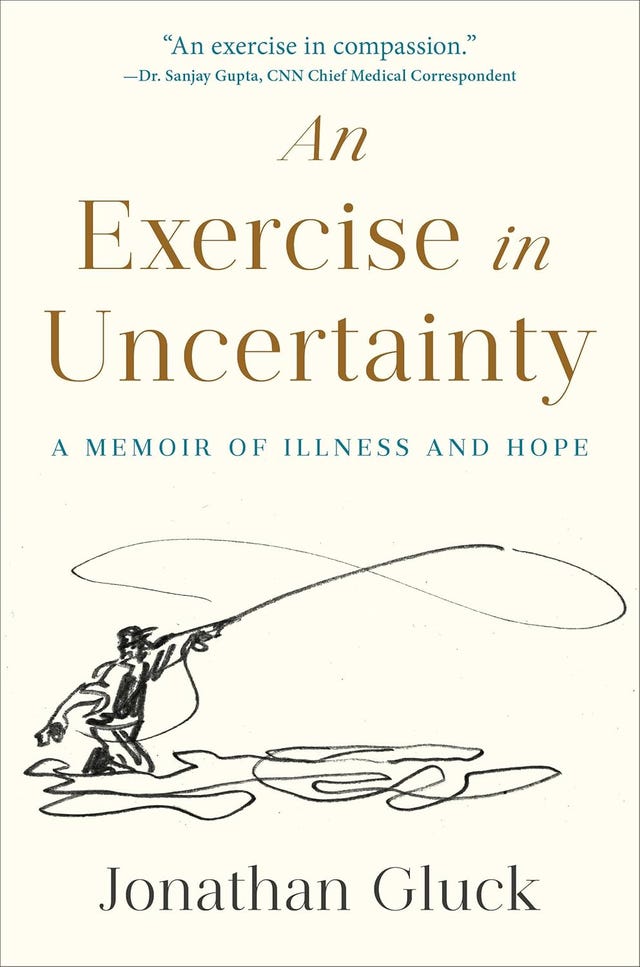
Le lundi 26 juin, je me suis à nouveau rendu au Mont Sinaï, cette fois pour recevoir mon traitement CAR-T. Les médecins et les infirmières nous ont expliqué, à Didi et moi, que la perfusion serait indolore et ne prendrait qu'une demi-heure environ.
Après cela, ils me surveilleraient attentivement – d’abord toutes les quinze minutes, puis toutes les demi-heures, puis toutes les heures, et plusieurs fois par jour par la suite – pour détecter d’éventuels symptômes de CRS et de neurotoxicité pendant toute la durée de mon séjour de deux semaines à l’hôpital.
Le suivi du SRC comprendrait des analyses de sang, des prises de température et de tension artérielle. Le dépistage de neurotoxicité consisterait à me demander si je connaissais mon nom, le jour où j'étais, la ville où je me trouvais, etc., ainsi qu'à effectuer des tests d'écriture pour évaluer mes capacités motrices.
Comme on nous l'avait dit auparavant, je n'aurais droit qu'à un nombre limité de visiteurs, et chacun devait porter un masque. J'étais arrivée avec deux romans, trois livres de mots croisés et mes abonnements Netflix, Hulu et Peacock. Mes sœurs et mon frère m'ont envoyé une photo de nous quatre, prise lors d'un mariage familial, à garder à côté de mon lit.
J'avais prévu de travailler pendant mon séjour à l'hôpital. Le Dr Richard m'a soutenue. « Ça m'aiderait à me changer les idées, m'a-t-elle dit. » Pour éviter que les réunions Zoom ne soient angoissantes, je désactiverais ma caméra ou je personnaliserais mon arrière-plan pour ne pas représenter une chambre d'hôpital.
Le moment venu, une infirmière a amené une potence à perfusion avec la poche contenant mes cellules CAR-T suspendue. Le liquide dans la poche était incolore et globalement banal, comme de l'eau. Je me souviens m'être demandé comment quelque chose d'aussi extraordinaire pouvait paraître si banal.
L'infirmière a ensuite pris la tubulure en plastique sortant de la poche et l'a fixée au cathéter placé dans ma poitrine plus tôt dans la journée. J'ai vu les premières gouttes pendre de la valve au fond de la poche, puis se détacher et descendre le long de la tubulure jusque dans mes veines.
Didi était assise à côté de mon lit, dans le fauteuil visiteur.
« D'accord, les cellules », dit-elle. « Travaillez. »
Pendant les premiers jours de mon hospitalisation, je me sentais bien. Je ne m'amusais pas comme un fou. Les prises de température, de tension, les prises de sang et les tests cognitifs étaient incessants.
« Est-ce que tu ressens de la douleur ? »
"Non."
« Je vais prendre votre tension artérielle maintenant. »
"D'accord."
« Et maintenant ta température. »
"Bien sûr."
Et ainsi de suite.
J'ai été piqué des centaines de fois. J'y suis habitué. Mais être réveillé chaque nuit à minuit et à 3 heures du matin pour me faire piquer, c'était nouveau pour moi.
La douche était un vrai casse-tête. À cause du cathéter, je n'avais pas le droit de prendre une douche classique, car je risquais de développer une infection. Mais comme mon immunité était affaiblie, je devais garder ma peau propre pour éviter les infections. La solution prescrite était des lingettes désinfectantes spéciales, utilisables quotidiennement sur la peau. Je peux vous dire qu'elles ne remplacent pas une douche.
Pour les tests cognitifs, un médecin ou une infirmière me demandait d'écrire « ma phrase », une copie d'une phrase qu'ils m'avaient demandé d'écrire le premier jour comme référence pour évaluer ma motricité fine. Ma phrase était : « Aujourd'hui, j'ai pris mon petit-déjeuner, regardé la télévision, lu un livre et fait un tour dans le couloir. » Shakespeare !
Ensuite, un médecin ou une infirmière me posait une série de questions.
"Quel est ton nom?"
« Jonathan Gluck. »
"Où es-tu?"
« Hôpital Mont Sinaï. »
« Dans quelle ville ? »
"New York."
"Quel âge as-tu?"
« Cinquante-huit. »
« Qu'est-ce que c'est ? » [Montrant la télévision.]
« Une télévision. »
Etc.
Finalement, ils me demandaient de lever la main droite, de toucher mon nez avec mon doigt, ou quelque chose de ce genre.
Le troisième ou le quatrième jour, quand une des infirmières m’a demandé de lever la main, je ne l’ai pas fait immédiatement.
Elle s'arrêta.
« Ça va, Jonathan ? » demanda-t-elle.
« Tu n'as pas dit : 'Simon dit' », ai-je dit.
Pour mémoire, elle a ri.
L’ennui était un autre problème.
Pour passer le temps, j'ai regardé la deuxième saison de The Bear en boucle (excellente). J'ai lu deux livres écrits par d'anciens collègues ( Bad Summer People , d'Emma Rosenblum, et The Eden Test , d'Adam Sternbergh). J'ai terminé trois compilations de mots croisés du New York Times (ma maîtrise des mots croisés n'a jamais été aussi bonne). Et j'ai regardé littéralement chaque minute du Tour de France, soit plus de quatre-vingts heures de courses cyclistes télévisées. (Découvrez la victoire palpitante de Jonas Vingegaard lors du contre-la-montre de la 16e étape, où il porte un coup décisif à son rival de longue date, Tadej Pogačar, sur YouTube.) Comme regarder du sport à la télévision a toujours été une sorte de Prozac pour moi, j'ai ajouté quelques dizaines de matchs de Wimbledon (ravi pour Carlos Alcaraz, triste pour Ons Jabeur), le tournoi de golf féminin de l'US Open (félicitations à Allisen Corpuz, première gagnante d'un tournoi majeur), et une dose nocturne de matchs des Yankees et des Mets (tous aussi agréablement ennuyeux l'un que l'autre) pour faire bonne mesure. Quant à la question de savoir si j'ai regardé un tournoi de cornhole sur ESPN, j'invoque le cinquième argument. (Allez, Jamie Graham !)
Si vous percevez un thème d'évasion, vous avez raison. Pendant mon séjour à l'hôpital pour mon traitement DCEP, j'avais lu Endurance , le récit d'Alfred Lansing sur l'expédition malheureuse de Shackleton. Je pensais que cette épopée de survie pourrait m'inspirer (au moins, je n'étais pas coincé sur une banquise antarctique à manger de la graisse de phoque pour survivre), et dans une certaine mesure, ce fut le cas. Mais c'était aussi peut-être un peu trop intense. Ma propre saga, me suis-je dit, était déjà assez poignante.
Je vous épargnerai mes plaintes concernant la nourriture de l'hôpital. En fait, non. Mais je les limiterai au café. Le café était horrible. Horrible. Sans doute diabolique. D'ailleurs, j'hésite à l'appeler café. C'était du Nescafé instantané, le genre qu'on emballe dans ces petits sachets fins pour leur donner un air européen, versé dans un gobelet en polystyrène rempli d'eau tiède. Vous connaissez ces petites flaques qui se forment au bord de la route après une averse, celles avec des nappes d'huile multicolores à la surface ? Le café n'avait pas ce goût ; il était pire. Avez-vous déjà oublié de changer le filtre à eau sous votre évier pendant trois ans, jusqu'à ce qu'il soit tellement saturé de saletés et de bactéries qu'il pourrait être considéré comme un site Superfund ? Imaginez : essorer ce filtre et boire le produit final. Et puis, compte tenu du fait que le café était dix fois pire.
Autrement dit, le quatrième jour, j'ai commencé à me faufiler au Starbucks du hall de l'hôpital, malgré le risque d'infection que cela représentait, pour prendre ma dose de caféine. Autrement dit, le café de l'hôpital était si mauvais que j'ai risqué ma vie pour ne pas le boire.
Heureusement, comme j'étais désormais gravement immunodéprimée, on m'a attribué une chambre individuelle. Cela m'a permis d'avoir de nombreuses heures de libre. Didi m'a confié qu'elle aimait parfois partir en voyage d'affaires, car séjourner seule dans une chambre d'hôtel lui offrait une rare échappatoire à mes exigences, celles des enfants, des chats et de tout le reste. C'était un moment précieux de solitude. Cette idée m'a peut-être traversé l'esprit, ou pas.
Un matin, alors que je retournais dans ma chambre après avoir pris un café dans le hall, je suis tombé sur un post-it jaune placé à côté des boutons Haut et Bas d'un ascenseur.
On pouvait y lire : « Chaque jour sur terre est un bon jour ! Bisous. »
À la personne qui a écrit cette note, je dis : « Amen. »
Le jour de ma sortie était le mardi 11 juillet. J’ai eu un dernier contrôle (« Avez-vous mal ? »), mon cathéter a été retiré et j’étais libre de partir.
Didi avait apporté un sac rempli de maquillage, de vernis à ongles et de crèmes pour le visage en guise de remerciement pour le personnel soignant. Nous l'avons laissé à l'infirmière en chef et nous sommes dirigés directement vers les sorties, comme on dit dans les émissions de télévision sur les hôpitaux.
En chemin vers les ascenseurs, j'ai croisé une femme que j'appellerai Barbara. Barbara était une autre patiente du traitement CAR-T et l'une des assistantes. Oubliez ça. C'était elle, l'assistante. Elle était là tous les jours, marchant d'un pas ferme, pendant une heure ou plus, à un rythme au moins trois fois supérieur au nôtre. Elle avait peut-être soixante-cinq ans et dégageait une attitude forte et calme. Son expression semblait dire : « Je suis consciente de ton pouvoir, cancer. Mais je suis désolée, tu ne me vaincras pas. »
Il était évident que je partais ; j'avais ma valise avec moi.
Barbara et moi avions déjà discuté à plusieurs reprises et échangé quelques banalités. Mais à ce moment-là, nous n'avions plus besoin de parler. Nous nous comprenions parfaitement, presque par télépathie. Chacune de nous se disait : « Je suis désolée. Je comprends. Bonne chance. »
Adapté de Un exercice d'incertitude , Harmony Books 2025
esquire





