Il s’avère que le cerveau des psychopathes est très différent.

Des différences structurelles significatives ont été observées dans le cerveau de personnes présentant des niveaux élevés de traits psychopathiques, dans des régions associées au contrôle des impulsions et à la régulation émotionnelle. Cette nouvelle étude, menée conjointement par des chercheurs américains et allemands, offre des perspectives importantes pour une meilleure compréhension de ces personnes et pourrait également jeter les bases scientifiques de futures approches de réadaptation.
La psychopathie est l'un des concepts les plus mal compris de la société. Bien que souvent utilisé comme synonyme de « mal », les manuels de psychiatrie modernes ne proposent pas de catégorie diagnostique formelle pour la « psychopathie ». Au contraire, des traits tels que l'absence d'émotion, les attitudes manipulatrices, le charme superficiel, le manque d'empathie et le comportement antisocial sont considérés comme des schémas de personnalité et présentés sur un spectre.
Les individus présentant un trait de personnalité plus prononcé, comme celui observé chez Chip, sont connus pour être plus susceptibles de présenter un comportement violent, d'être impliqués dans des activités criminelles et de récidiver. Par conséquent, l'exploration du lien entre les traits psychopathiques et le cerveau est considérée comme un sujet aux implications importantes, tant au niveau individuel que sociétal.
Différences dans le cerveauDans cette nouvelle étude, les cerveaux de 39 participants masculins présentant des scores élevés de psychopathie ont été examinés par IRM fonctionnelle. Les participants ont été évalués à l'aide de la liste de contrôle révisée de la psychopathie (PCL-R), une échelle de 20 items largement utilisée dans les études cliniques. Elle mesure deux dimensions fondamentales de la psychopathie : la première englobe le détachement émotionnel et la distance, et la seconde les comportements liés aux tendances antisociales.
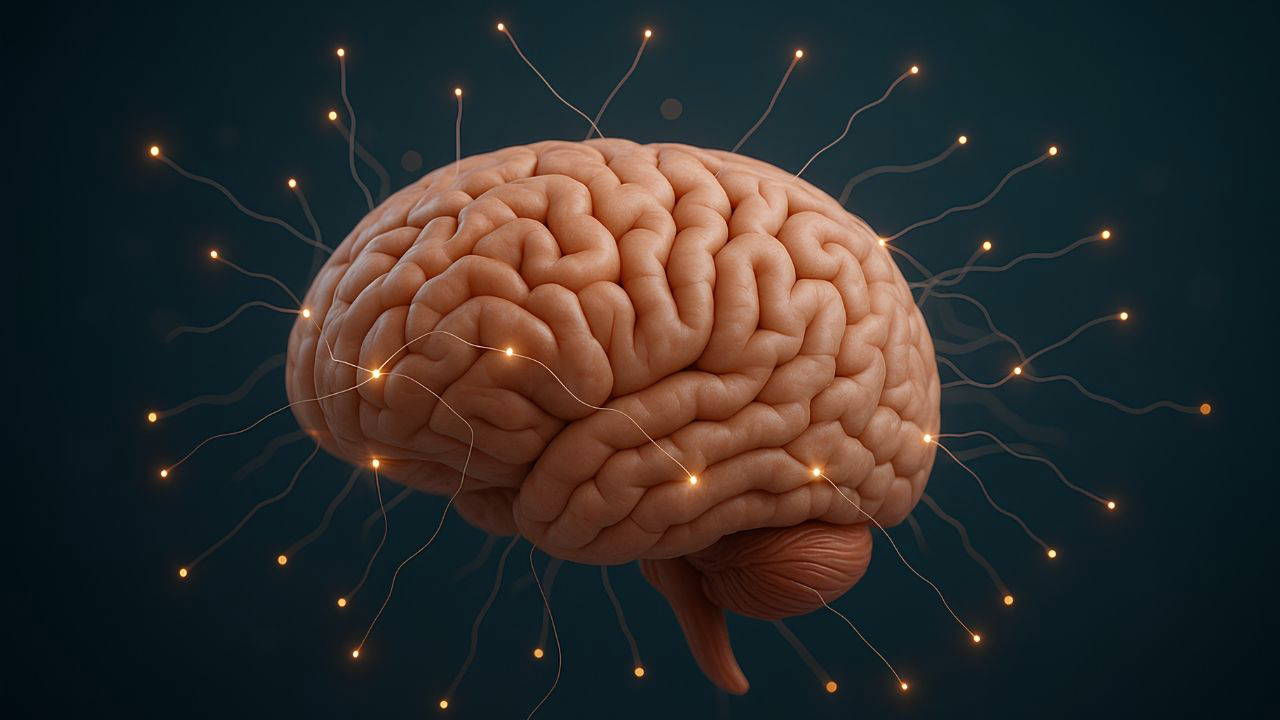
Des individus présentant un niveau élevé de psychopathie ont été comparés à un groupe témoin sans traits psychopathiques. Les analyses volumétriques réalisées à l'aide de l'Atlas cérébral de Julich ont révélé des différences structurelles significatives, notamment dans les régions correspondant à la deuxième dimension (comportement antisocial).
L'étude a révélé une perte de volume dans des régions telles que les noyaux gris centraux, le thalamus et le cortex insulaire. Ces régions sont associées à de nombreuses fonctions fondamentales, notamment le contrôle des impulsions, la cognition sociale, la perception de la récompense et le traitement des émotions. Globalement, les personnes présentant des niveaux élevés de psychopathie présentaient un volume cérébral inférieur d'environ 1,45 % à celui des témoins. Les différences les plus frappantes se concentraient dans certaines parties du cortex, le cortex cingulaire antérieur et des sous-zones spécifiques de l'hippocampe.
Que signifient ces résultats ?Les résultats suggèrent que les comportements associés à la psychopathie ne s'expliquent pas uniquement par des facteurs sociaux ou environnementaux ; ils pourraient également avoir une origine neurologique. L'équipe de recherche émet l'hypothèse que les tendances psychopathiques pourraient résulter d'une anomalie développementale cérébrale chez certains individus.
Cependant, l'étude présente également des limites. La taille relativement réduite de l'échantillon soulève des questions quant à la généralisabilité des résultats. De plus, même si l'on suppose que les participants n'étaient pas sous l'influence de substances au moment de l'étude, une consommation passée à long terme de substances pourrait avoir affecté la structure cérébrale. Cela peut rendre les données difficiles à interpréter.
Les chercheurs soulignent la nécessité de mener des études de neuroimagerie plus complètes sur la psychopathie. Ces données sont cruciales pour le dépistage précoce des personnes atteintes et l'élaboration de stratégies d'intervention adaptées.
L’étude a été publiée dans la revue European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.
Cumhuriyet





