Bryan Caplan sur l'antitrust

J'ai commencé à lire l'excellent nouvel ouvrage de Bryan Caplan, intitulé « Pro-Market and Pro-Business : Essays on Laissez-faire » , et j'en ai parcouru les 12 (courts) premiers chapitres. J'espérais y trouver beaucoup de sujets à aborder, mais malheureusement, je suis plutôt d'accord avec la quasi-totalité des arguments de Bryan. Il y a cependant un chapitre sur le droit de la concurrence, que j'ai trouvé un peu décevant. Même si, même dans ce cas, je suis probablement d'accord avec les implications politiques de son argumentation :
Depuis 2007, Bill Gates a fait don de 28 milliards de dollars, soit 48 % de sa fortune. Frugal Dad estime avoir sauvé près de 6 millions de vies . Je n'ai pas vérifié ses sources, mais c'est une estimation plausible.
Dans les années 1990, Bill Gates bénéficiait d'une publicité bien moins favorable – et de poursuites judiciaires. Le gouvernement américain a poursuivi Microsoft pour violation des lois antitrust . En 2000, Alex Tabarrok estimait que cette affaire avait coûté 140 milliards de dollars aux actionnaires de Microsoft . Certes, Microsoft a finalement conclu un accord relativement favorable. Mais Gates aurait probablement gagné des milliards de dollars en l'absence de lois antitrust.
Si la philanthropie de Gates est aussi efficace que la plupart des gens le pensent, cela implique une conséquence choquante : le procès antitrust contre Microsoft a fait un nombre impressionnant de victimes. Gates sauve environ une vie pour chaque tranche de 5 000 dollars dépensés. Si le procès lui avait coûté 5 milliards de dollars et qu'il en avait redistribué 48 %, le droit de la concurrence aurait tué 480 000 personnes. Si le procès lui avait coûté 5 milliards de dollars et qu'il en avait redistribué jusqu'au dernier centime, le droit de la concurrence aurait tué un million de personnes. Imaginez le nombre de morts aujourd'hui si le gouvernement parvenait à mettre Microsoft à genoux et Gates à la faillite. C'est ahurissant.
J'ai avancé un argument similaire à propos de Bill Gates lorsque je parlais avec des gens, mais je pense que cela va un peu trop loin :
On pourrait objecter : « D'après les normes, Gates lui-même tue des millions de personnes en ne donnant pas davantage. » Si vous êtes conséquentialiste, c'est tout à fait exact ; nous sommes tous des meurtriers aux yeux de Jeremy Bentham et Peter Singer. Mais si l'on s'en tient à la distinction de bon sens entre « tuer » et « laisser mourir », Gates est innocent, et le gouvernement reste coupable.
Je ne trouve aucune de ces interprétations de bon sens. Je suis conséquentialiste et je ne crois pas que s'abstenir de faire la charité soit un meurtre. Je ne crois pas non plus qu'une « distinction de bon sens » puisse déclarer le gouvernement américain coupable de meurtre dans cette affaire.
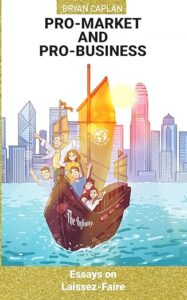
L'antitrust implique à la fois des questions d'efficacité et d'équité. Je suis sceptique quant à l'efficacité de l'action antitrust intentée par le gouvernement américain contre Microsoft, et je soupçonne Bryan de l'être également. Par conséquent, nos positions politiques aboutiraient probablement à peu près au même résultat. Mais le message de Bryan se concentrait implicitement sur l'impact de la redistribution , et non sur l'efficacité ; c'est donc sur ce point que je souhaite aborder mes commentaires.
La logique de ce chapitre suggère que la redistribution des revenus des riches vers la classe moyenne est néfaste d'un point de vue utilitariste, car les riches ont une bien plus forte propension à aider les plus pauvres. Dans le cas de Bill Gates, c'est probablement vrai. Mais les politiques publiques ne doivent pas être construites en fonction de leur impact sur un individu en particulier ; il faut plutôt considérer l'effet global de toute politique de redistribution. Nombre de riches dépensent leur fortune en consommation et/ou font des dons à des causes telles que des universités fortunées et des fondations éveillées.
L'antitrust est un exemple étrange à utiliser pour aborder ce genre de questions. Il est bien plus judicieux de réfléchir à la conception optimale des programmes fiscaux et de transferts lorsqu'on avance des arguments conséquentialistes fondés sur l'hypothèse selon laquelle le transfert de milliards de dollars aux milliardaires aiderait les plus pauvres du monde.
Si Bill Gates était un cas typique, il serait peut-être optimal d'augmenter fortement les impôts des Américains de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure, et de réduire drastiquement ceux des milliardaires. Mais dans ce cas, une politique encore plus efficace serait un régime de taxe à la consommation fortement progressif, dont les recettes seraient affectées exactement au type de programmes d'aide étrangère récemment sabrés par les partisans du DOGE. On pourrait arguer que cette réorientation des fonds vers les pays pauvres est politiquement irréaliste, car la plupart des électeurs pensent que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vrai, mais il est également vrai qu'une politique de forte hausse des impôts sur la classe moyenne n'est pas particulièrement populaire.
Alors, qu'est-ce qui est politiquement faisable ? Une réponse possible est que, quelle que soit la décision du Congrès cette année, ce sera la seule politique fiscale politiquement viable à l'heure actuelle. Je considère ce type de raisonnement comme excessivement défaitiste. Un impôt sur la consommation très progressif pour les riches n'est pas facile à faire accepter au Congrès, mais il est certainement moins impopulaire que l'adoption d'un régime d'impôt sur le revenu très régressif. Avec un impôt sur la consommation très progressif, Bill Gates n'est en aucun cas découragé d'aider les plus pauvres du monde. Et pourtant, ce plan ne nous oblige pas à nous soucier du bien-être des milliardaires lorsque nous réfléchissons à une politique fiscale et antitrust optimale.
Encore une fois, je ne suis pas certain que Bryan soit en désaccord avec ces points de vue politiques. Mais dans un monde où beaucoup sont conséquentialistes, je crains qu'il soit inutilement provocateur de suggérer que le monde se porterait mieux si nos milliardaires les plus riches étaient encore plus riches. On peut parvenir au même résultat avec un impôt sur la consommation fortement progressif, sans pour autant décourager les partisans potentiels du libre marché et des grandes entreprises.
En matière de lutte contre la concurrence, je préférerais qu'elle se concentre exclusivement sur les questions d'efficacité (ce qui implique principalement de s'attaquer aux barrières gouvernementales à l'entrée) et que les questions de redistribution relèvent de notre système fiscal et de transferts. Si l'affaire Microsoft a été contre-productive, c'est parce qu'elle a rendu notre économie moins efficace.
econlib





