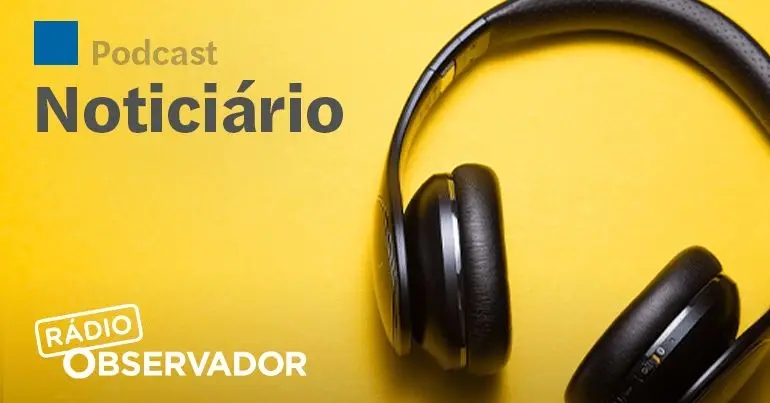Préparer la paix ? Leçons de l'Antiquité dans une Europe incertaine

Pendant des décennies, de nombreux Européens ont tenu la paix et la sécurité pour acquises. Cependant, les récents développements géopolitiques nous rappellent que la paix, outre son caractère précieux, est aussi profondément précaire. Les menaces de guerre ne se limitent plus à des continents lointains, ni même aux frontières de l'Europe. Les nouveaux investissements massifs dans la défense militaire reflètent une réalité inquiétante, tandis que le vieil adage latin si vis pacem, para bellum – « Si tu veux la paix, prépare la guerre » – est à nouveau pris au pied de la lettre et considéré comme un principe essentiel.
D'une certaine manière, les dilemmes de notre époque et les désenchantements récents semblent faire écho à des idées déjà débattues par les auteurs des premiers siècles de l'Empire romain. Cette époque, si souvent idéalisée par sa Pax Romana , débuta lorsque le premier empereur, Auguste, sortit victorieux des guerres civiles qui avaient déchiré la République romaine, en battant Marc Antoine et Cléopâtre à Actium en 31 av. J.-C. Dès lors, il proclama une nouvelle ère de stabilité et de prospérité. Cette « paix », qui dura deux siècles jusqu'à la mort de Marc Aurèle en 180 apr. J.-C., fut largement célébrée dans tout l'empire, alors même que les légions romaines continuaient de se livrer guerre à ses frontières, du nord au sud et d'ouest en est. L'illusion d'une paix durable masquait ainsi des tensions latentes.
Les intellectuels de l'époque réfléchissaient fréquemment au concept de Pax Romana , et nombre d'entre eux vantaient cet état apparemment béni dans leurs œuvres littéraires. Mais cet éloge ne signifiait pas qu'ils ignoraient ses contradictions. Au contraire, ils s'interrogeaient sérieusement sur ce qu'était véritablement la paix et comment la préserver pour les générations futures. L'un des principaux ressorts de ce discours pacifiste était le recours aux exempla : des récits de personnages illustres du passé, destinés à instruire les lecteurs sur la complexité du comportement humain, en soulignant à la fois les vertus et les vices.
Parfois, ces auteurs s'adressaient directement aux empereurs, tentant d'influencer leurs décisions et de les guider vers la préservation de cette paix fragile. Le philosophe et biographe grec Plutarque de Chéronée, par exemple, a rassemblé environ cinq cents anecdotes dans son ouvrage « Dictons de rois et de généraux », dédié à l'empereur Trajan vers 117 apr. J.-C., la dernière année de son règne expansionniste. Des analyses récentes suggèrent que, par ces exemples , Plutarque cherchait à encourager l'empereur à privilégier la stabilité interne de l'empire, à l'instar du « pacificateur » Auguste.
Ironie du sort : nombre des héros représentés par Plutarque et ses contemporains ont activement participé à des guerres, souvent en tant que commandants. Cela n'est pas surprenant, car les conflits sont souvent le théâtre d'actions extraordinaires et de dilemmes éthiques complexes. Cependant, la dynamique sanglante du passé gréco-romain a appris aux écrivains des Ier et IIe siècles que le rêve d'une Pax Romana perpétuelle pouvait être une illusion. La paix ne doit pas être tenue pour acquise. Le fait qu'ils aient revisité à maintes reprises les horreurs et les traumatismes des générations précédentes révèle une profonde conscience de leur fragilité.
Aujourd'hui, face à une nouvelle vague d'insécurité, la tradition classique ne nous offre ni réponses simples ni solutions faciles. Mais elle nous rappelle que la paix exige un effort constant et le courage d'apprendre du passé. Tout comme les intellectuels romains cherchaient à façonner leur avenir en réfléchissant aux conflits passés, nous devons nous aussi continuer à revisiter l'histoire, non pas pour glorifier la guerre, mais pour retarder, prévenir ou atténuer ce qui peut parfois sembler inévitable.
Laurens van der Wiel, chercheur postdoctoral à l'Université de Varsovie, et Wim Nijs, chercheur postdoctoral à l'Université de Toronto et conférenciers à la Celtic Conference in Classics
sapo